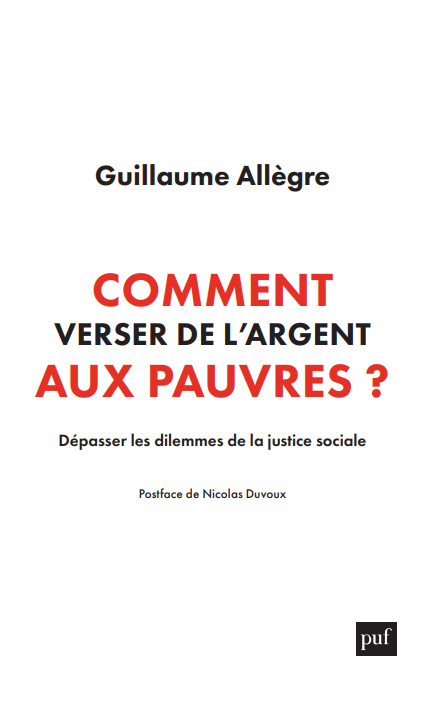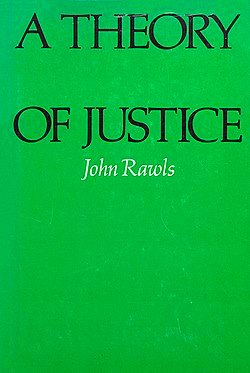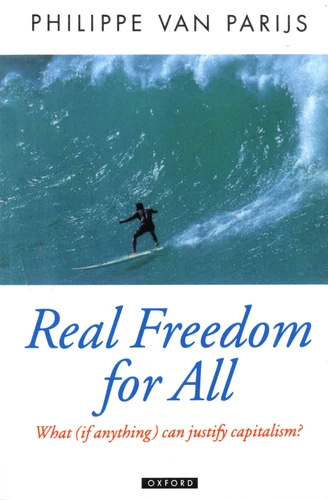“Comment verser de l’argent aux pauvres” est le titre de mon ouvrage paru aux PUF en janvier 2024 (lien). Je le présente demain, 17/12, dans une réunion organisée par ATD-Quart monde et le Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB), ce qui me permet de le représenter ici.
Pourquoi ce titre ? Déjà parce que c’est le programme de l’ouvrage qui répond à cette question et aux sous-questions : A quel niveau ? Faut-il conditionner l’aide à des efforts d’insertion sociale et professionnelle ou verser un revenu inconditionnel ? Faut-il mieux cibler les prestations ou les verser à tout le monde ?
Le titre de l’ouvrage fait référence à plusieurs sources. Il fait référence à ceux qui dans le monde anglo-saxon plaident pour juste donner de l’argent aux pauvres “Just Give Money to the Poor”, slogan souvent associé au revenu universel, notamment à l’aide au développement versée sous forme monétaire et court-circuitant États et ONGs (par exemple givedirectly donne en Afrique à des ménages de l’argent collecté aux Etats-Unis). Le titre est parfois lu comme une provocation de gauche court-circuitant la question “Doit-on verser de l’argent aux pauvres ?”. En réalité l’ouvrage ne prend pas ces voies-là. L’ouvrage essaye d’éviter un double écueil. Premièrement, l’écueil du solutionnisme, dans lequel tombent parfois les défenseurs du revenu universel. Le “solutionnisme” tend à trouver une solution miracle répondant à plusieurs questions à la fois ou plusieurs dilemmes ; solution que l’on est censé accepter en bloc. Le revenu universel répond ainsi en bloc à trois des questions abordées plus haut (il est individuel, inconditionnel, universel) et est souvent censé résoudre des problèmes très divers (les problèmes sociaux et le problème écologique) via un seul instrument (solution millefeuille). L’ouvrage essaye également d’éviter l’écueil du volontarisme politique selon lequel tout serait politique, il n’y aurait pas de dilemme technique, et que tout ce qui manque c’est un peu de volontarisme politique (en faveur de la réduction des inégalités) parmi les décideurs politiques. Il est possible de naviguer entre ces deux écueils et de répondre aux questions de manière analytique, en distinguant dans un premier temps celles-ci. Mais cela nécessite de répondre d’abord à la question pourquoi ?
Pourquoi ? Une première réponse est la garantie du droit constitutionnel à des “moyens convenables d’existence” (Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946). Ce droit positif à des ressources économiques n’existe dans la constitution (et traités divers), que depuis le milieu du XXème siècle, soit un siècle et demi après la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 qui édicte notamment que l’imposition doit être répartie en raison de la “faculté contributive”. Pourquoi un droit à des moyens d’existence ? La meilleure réponse il me semble se trouve chez Rawls, dans la Théorie de la Justice (1971), ouvrage qui tente de donner des fondements solides à la justice distributive, qui soient non-utilitaristes, les arguments utilitaristes étant jugés peu convaincants. La théorie de la justice de Rawls tient en trois principes hiérarchisés :
Le principe d’égale liberté : “chaque personne doit avoir un droit égal au système total le plus étendu de libertés de base égales pour tous, compatible avec un même système pour tous”.
Le principe d’égalité des chances : “les inégalités économiques et sociales doivent être telles qu'elles soient attachées à des fonctions et des positions ouvertes à tous, conformément au principe de la juste égalité des chances.”
Le principe de différence: “les inégalités économiques et sociales doivent être telles qu'elles soient au plus grand bénéfice des plus désavantagés.”
Le dernier principe est aussi appelé “maximin” puisqu’il s’agit de maximiser la situation des plus désavantagés. Pourquoi ? L’ouvrage présente plusieurs justifications. Celle que je trouve la plus convaincante est la suivante : l’organisation sociale, telle qu’elle existe aujourd’hui sous la forme des droits de propriété, de la division du travail, de la coopération sociale en générale, bénéficie le plus à ceux qui sont sont les plus aisés et le moins à ceux qui sont les plus pauvres. Pour s’assurer que la coopération se fasse réellement au bénéfice de tous, alors il faut maximiser la situation des plus désavantagés (comme proxy de ceux qui bénéficient le moins des institutions actuelles).
Si l’on part de ces raisons pourquoi alors la réponse aux questions posées ci-dessus est plus simple, au moins dans un premier temps :
A quel niveau ? Au niveau qui maximise l’insertion sociale des plus défavorisés.
De façon conditionné ? Oui, car la garantie de moyens convenables d’existence est justifiée par la coopération sociale, donc elle ne peut justifier les “surfeurs”.
De façon ciblée sur les plus pauvres pour répondre également à la logique de besoin.
De façon familialisée car cela répond à une logique de besoin, et que les couples bénéficient d’économies d’échelles (il faut compenser le désavantage des personnes seules).
Les différents chapitres de mon ouvrage reviennent plus longuement sur ces réponses.
A quel niveau ? Aujourd’hui le RSA est très faible, 635 euros contre 1015 euros pour l’AAH et le minimum vieillesse. Avec un Smic à 1425 euros net, le niveau du RSA ne peut se justifier par les incitations au travail. Les incitations existent et continueront à exister à des niveaux bien plus élevés du RSA. Les pays scandinaves cumulent des niveaux plus élevés de RSA et des taux d’emploi plus élevés des personnes peu qualifiées. Jusqu’à quel niveau peut-on augmenter le socle ? La littérature montre que le niveau actuel n’est pas désincitatif mais cela ne veut pas dire que l’on peut augmenter le RSA jusqu’au niveau du Smic. On peut réfléchir à augmenter le RSA progressivement, disons de 300 euros en 5 ans au-delà de l’indexation normale. La loi prévoirait un suivi précis des effets par une commission indépendante pluraliste, qui pourrait recommander d’arrêter les augmentations si elle décèle des risques importants, ou des effets avérés. On peut aussi imaginer une clause de revoyure selon laquelle l’objectif devrait être redéfini ou confirmé au bout de trois ans. Même si la convergence va jusqu’à son terme, la commission resterait toujours active afin d’évaluer les possibles effets de long terme. Si des risques sont décelés plus tard, il est toujours possible de réduire le minimum relativement aux autres revenus, en le désindexant de l’inflation. La mise en œuvre de cette proposition constituerait une expérience et non une expérimentation. Il existe plusieurs avantages à ce type d’expérience, ou de mise en place expérimentale, par rapport aux expérimentations (notamment les expérimentations contrôlées). Dans une expérience, tous les effets peuvent être évalués, notamment les effets d’équilibre et les éventuels changements de normes sociales. Dans une expérience, ce qui est évalué est l’instrument lui-même. Aussi la loupe n’est pas mise sur les contre‑productivités puisque les effets directs de la réforme existent. L’expérience rend les bénéficiaires et les associations qui les accompagnent, propriétaires de l’expérience, beaucoup plus que dans une expérimentation. Si les expérimentations ont une tendance conservatrice, ce type d’expérience apparaît comme une force progressiste dans la mesure où elles altèrent le statu quo.
De façon conditionnée ? C’est la question la plus clivante et la plus difficile. Les défenseurs du revenu universel sont très attachés à l’inconditionnalité. Mais que faire du surfeur, de la figure du joueur de tarot, celui qui ne veut pas participer à la coopération sociale ? Une réponse est de dire que ces personnes ne sont pas très nombreuses, ce qui est probablement vrai avec un RSA aussi faible. Mais si le minimum était plus élevé ? Il y a un arbitrage entre générosité du minimum et inconditionnalité. Les citoyens cherchent une forme de contrôle sur les dépenses sociales et ce contrôle peut venir soit d’un minimum très faible, soit de la conditionnalité. Aujourd’hui on a les deux (mais la conditionnalité est assez faible), on peut difficilement imaginer un minimum à la fois très généreux et totalement inconditionnel. Il faut répondre malgré tout à l’objection du surfeur (faite par Rawls à Van Parijs). Dire qu’ils ne sont pas très nombreux ne suffit pas si cette objection est répétée inlassablement par les opposants politiques (et si on met le-dit surfeur sur la couverture de son livre). Parler revenu universel, c’est forcément mettre le surfeur au centre du débat or cette figure divise la gauche travailliste et la gauche convivialiste. Aussi, les réponses à l’objection de Rawls ne sont d’après-moi pas très convaincantes. Le revenu universel serait la contrepartie des droits aux ressources naturelles (terre, etc). Mais si c’est le cas, il devrait alors être versé au niveau mondial. Pourquoi le verser au niveau de la communauté politique, aux Français et pas aux Africains, si chacun a un droit égal à la terre ? Ce droit n’existe au sein d’une communauté politique que dans une optique contractualiste parce qu’il ferait partie du contrat social. Mais pourquoi alors le verser de façon inconditionnelle, à ceux qui ne respectent pas le principe de réciprocité et donc le contrat social ? Cet argument n’est pas une dénonciation du surf ou du loisir. Ce n’est pas un argument en faveur d’une éthique du travail, c’est un argument favorable à une juste répartition du loisir et du travail (pour ceux capables de travailler), et de relations sociales réciproques. Dans cette optique, la réduction du temps de travail devrait plutôt se faire de manière collective dans une logique de droit effectif au loisir pour tous, comme expérience partagée.
De façon ciblée ou universelle ? Le ciblage est probablement plus favorable aux moins aisés. Le paradoxe de la redistribution (selon lequel “une politique pour les pauvres est une pauvre politique”) ne fonctionne pas pour des prestations monétaires aussi généreuses. Si l’objectif est un RSA socle à plus de 900 euros, il est difficile d’imaginer que l’universalité c’est à dire le fait de verser 900 euros à tous, plutôt que de façon dégressive, rende cet objectif plus facile à atteindre. Cette approche ne s’oppose pas à l’école, l’hôpital, les transports publics, les musées, les parcs et les plages gratuits, car un des objectifs de ces politiques est justement l’expérience commune.
De façon familialisée pour répondre à une logique de besoins et parce que les couples bénéficient d’économies d’échelle au-delà des dépenses de logement au sens strict (équipements, abonnements, éventuellement voiture, charge des enfants…). Il existe un dilemme entre la familialisation (qui répond à une logique de besoin) et l’individualisation (qui répond à une logique d’autonomie et qui défendue dans une logique féministe). La réponse n’est pas évidente et ne peut être prouvée facilement. L’idée est que ce n’est pas l’instrument le plus efficace pour répondre à ces préoccupations. Il est préférable, pour répondre aux logiques d’autonomie et d’égalité femmes-hommes, de faire jouer prioritairement d’autres politiques : modes de garde, éducation, enseignement supérieur, logement, etc. Or le coût d’un revenu universel risque de réduire les financements de ces services publics visant l’autonomie.
En conclusion, Au lieu d’essayer de mettre tous les allocataires de prestations sociales sous un même parasol, il faut au contraire viser à minimiser le nombre de bénéficiaires des revenus d’assistance par des politiques, assurantielles et universelles, s’adressant aux individus : éducation et santé, assurance chômage et salaire minimum élevé, politiques macroéconomiques visant le plein-emploi. Il s’agit en somme d’une stratégie sociale‑démocrate relativement classique.